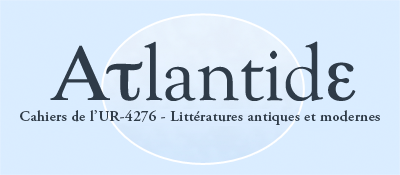4. Shakespeare au XIXe siècle
4. Shakespeare au XIXe siècle
Sous la direction de Line Cottegnies et Gisèle Venet
Numéro 4 - Décembre 2015
Avant-propos - Line Cottegnies & Gisèle Venet
« C’est shakespearien ! » : Shakespeare au XIXe siècle entre fascination et rejet
Dans le langage commun, l’expression française « C’est shakespearien », comme les adjectifs « proustien » ou « kafkaïen », tente d’exprimer le sentiment qui saisit devant des situations ou des affects qui dépassent non seulement l’expérience ordinaire, mais surtout outrepassent tous les modèles littéraires plus familiers auxquels on voudrait se référer dans notre héritage culturel français. En particulier au théâtre, si longtemps dominé en France par les règles dérivées de la Poétique d’Aristote, alors que Shakespeare, en dramaturge maniériste et baroque, avait d’emblée rejeté tout aristotélisme. La résistance française, qui met en fureur Stendhal, coïncide bien en effet avec cet excès de fidélité à un théâtre dominé par les trois unités et le decorum horatien, et s’exercera sur le plan dramatique, comme l’a bien détecté Stendhal, à l’encontre de Shakespeare dans certaines coteries « classiques », avant que le mouvement romantique ne s’en empare et que l’œuvre shakespearienne ne devienne la déferlante qu’elle continue d’être, celle de « l’homme océan » comme Victor Hugo aimait décrire le poète [1].
Pourtant, dans sa Dix-huitième lettre philosophique « Sur la tragédie » (1734), Voltaire aurait pu forger lui-même l’expression « C’est shakespearien », tant il exprime une fascination pour cette œuvre et le sentiment d’étrangeté culturelle radicale qui séparera si longtemps Shakespeare du génie français. Il explicite ce sentiment de distance culturelle infranchissable malgré l’attirance exercée : « il y a de si belles scènes, des morceaux si grands et si terribles répandus dans ses farces monstrueuses qu’on appelle tragédies, que ces pièces ont toujours été jouées avec un grand succès » [2]. Devant les irrégularités du génie shakespearien, Voltaire concède que « [l]e temps, qui seul fait la réputation des hommes, rend à la fin leurs défauts respectables. La plupart des idées bizarres et gigantesques de cet auteur ont acquis au bout de deux cents ans le droit de passer pour sublimes ». Mais il croit encore que si « les auteurs modernes l’ont presque tous copié […], ce qui réussissait chez Shakespeare est sifflé chez eux », fort de la certitude que « la vénération qu’on a pour cet ancien augmente à mesure que l’on méprise les modernes ». À cette date, il croit encore pouvoir écrire ce conseil avisé d’auteur classique – « On ne fait pas réflexion qu’il ne faudrait pas l’imiter, et le mauvais succès de ses copistes fait seulement qu’on le croit inimitable » (ibid.). Hugo fera dire avec plus de féroce ironie au comédien Talma : « Je demande Shakespeare, on me donne Ducis » [3].
Paradoxalement, le « romantique » Stendhal donne un même conseil, apparemment toujours selon des critères français, mais avec une visée toute différente : « Les Romantiques ne conseillent à personne d’imiter directement les Drames de Shakespeare. Ce qu’il faut imiter de ce grand homme, c’est la manière d’étudier le monde au milieu duquel nous vivons, et l’art de donner à nos contemporains précisément le genre de tragédie dont ils ont besoin, mais qu’ils n’ont pas l’audace de réclamer, terrifiés qu’ils sont par la réputation du grand Racine » [4].
Stendhal est pourtant convaincu de la force de cette notion qui s’installe autour de la perception du « shakespearien ». Et un Balzac, dans La Peau de chagrin (1831), manifestement libéré de toute inhibition racinienne ou classique, comparera en toute liberté un de ses personnages féminins à « une tragédie de Shakespeare, espèce d’arabesque admirable où la joie hurle, où l’amour a je ne sais quoi de sauvage, où la magie de la grâce et le feu du bonheur succèdent aux sanglants tumultes de la colère ; monstre qui sait mordre et caresser, rire comme un démon, pleurer comme les anges […] ; puis en un moment rugir, se déchirer les flancs, briser sa passion, son amant ; enfin, se détruire elle-même comme un peuple insurgé » [5]. Balzac, débarrassé des catégories dramatiques et des règles qui s’appliquent au théâtre, peut en toute liberté pleinement s’approprier cette vision paroxystique que représente pour l’imaginaire français le monde « shakespearien », rarement mieux appliqué qu’en dehors de toute écriture pour la scène.
Les textes publiés dans ce numéro 4 de la revue Atlantide sont presque tous issus de communications prononcées lors d’un atelier du congrès de la Société Française Shakespeare organisé en avril 2014 pour célébrer le 450e anniversaire de la naissance de Shakespeare. Cet atelier, intitulé « C’est shakespearien ! Fortune critique d’un lieu commun en France de 1820 à nos jours » s’était intéressé à l’histoire de ce topos et à sa présence obsessionnelle tant dans les biographies de Shakespeare que dans des traductions ou adaptations de son œuvre. Tout aussi pertinents pour notre propos étaient les résurgences de personnages de Shakespeare dans la conception de personnages romanesques du XIXe siècle français, ou l’effacement même de la référence shakespearienne dans la musique inspirée de cette œuvre.
Les deux articles de ce numéro consacrés à des vies de Shakespeare écrites au XIXe siècle montrent comment le genre de la biographie est façonné par son moment d’écriture et comment, par là même, la conception du génie propre à Shakespeare se modifie au gré des circonstances. Ainsi Christine Sukic détecte l’incidence de l’adjectif « shakespearien » et les connotations qui l’accompagnent sur des biographies qui paraissent tantôt conçues comme devant éclairer l’œuvre, comme le pensait La Place, tantôt au contraire comme chargées de souligner combien l’œuvre du poète était en contradiction avec sa vie, si l’on suit Amédée Pichot. Ces mêmes biographies par ailleurs pourraient tout autant avoir contribué à forger ou à renforcer le lieu commun dont elles éclairent une utilisation et une compréhension spécifiquement françaises.
Une version plus politique de la notion que recouvre l’adjectif « shakespearien » s’affirme à travers la biographie de Shakespeare écrite par Guizot telle que l’analyse Gabriel Louis Moyal. Publiée ostensiblement pour accompagner sa nouvelle traduction des œuvres complètes du dramaturge, De Shakespeare et de la poésie dramatique (1822), la biographie qu’il écrit s’avère un document qu’informent en profondeur les conflits politiques de la Restauration en France. Le tableau de l’Angleterre d’Élisabeth Ire et la biographie de Shakespeare s’y donnent à lire comme autant d’allégories, voire de leçons sur l’histoire de l’évolution de la constitutionnalité française ou sur celle du rôle du théâtre populaire dans la construction d’une culture politique. Ce texte, resitué dans une stratégie politique fondée sur une conception élargie de la traduction, révèle de nouvelles connotations pour cet adjectif « shakespearien ». Il en précise et en enrichit d’autant la valeur iconique dans l’imaginaire du politique en France, où il occupe une place de choix.
L’appropriation de l’œuvre de Shakespeare dans l’art lyrique montre, quant à elle, une version extrême du rapport que les Romantiques entretiennent avec la tradition littéraire. « Point de Shakespeare, rien ; un ouvrage manqué », s’exclame le compositeur français Hector Berlioz pour exprimer sa déception après la première parisienne de l’opéra de Bellini, I Capuleti e i Montecchi, en février 1833. Ladan Niayesh s’en fait l’écho avec humour, et examine les reproches que le compositeur français fait à cet ouvrage d’ailleurs inspiré non des deux célèbres familles ennemies dans Roméo et Juliette de Shakespeare, mais d’une novella italienne, leur source commune, et en utilisant un support, l’opéra, qui n’existait même pas du temps de Shakespeare. Pourtant, même avec un pareil déficit de sens au départ, elle se fait fort de démontrer que l’œuvre a toutes les caractéristiques de ce que l’on entend par « shakespearien » selon les critères du romantisme français au début des années 1830.
Comme le rappelle Chantal Schütz, Byron s’indigne lui aussi, vingt ans avant Berlioz, devant les transformations imposées à l’Othello de Shakespeare dans la première version lyrique de la pièce, que nous devons à Rossini (1816) : « They have been crucifying Othello » [6]. Le critique français Henri Blaze ira même jusqu’à reprocher au compositeur l’utilisation frauduleuse du nom de Shakespeare pour une œuvre qui, au fond, ne lui doit rien : « [S]aviez-vous seulement qu’un grand poète du nom de Shakespeare eût jamais existé [7] ? » C’est que librettiste de Rossini, Berio, s’était largement inspiré de l’adaptation française de la pièce par Ducis (1792) et de la transposition italienne qu’en donne Cosenza (1813), sans guère se soucier d’authenticité shakespearienne. De quoi Shakespeare est-il le nom, alors, dans l’opéra italien du XIXe siècle ? Comme pour l’Otello de Verdi plus tard (1887), l’œuvre de Shakespeare fournit un ensemble de motifs isolés et de résonances lointaines.
On trouve également des échos de Shakespeare dans la fiction française. Comme le montre Emilie Ortiga, si l’on ne peut attribuer à Balzac un ouvrage critique sur Shakespeare comparable à la « Préface » de Cromwell (1827) de Victor Hugo ou au Racine et Shakespeare (1823 et 1825) de Stendhal – ce qui explique que Balzac ne figure pas habituellement dans les études sur la réception de Shakespeare en France –, les nombreuses allusions et références à l’œuvre du dramaturge anglais dans ses œuvres suggèrent cependant une profonde influence du dramaturge élisabéthain. Le succès rencontré par Balzac pendant sa vie a donc paradoxalement permis une diffusion discrète, mais continue, de la référence shakespearienne. Cette présence de Shakespeare est particulièrement visible dans La Cousine Bette : publié en 1846, une vingtaine d’années après la parution de la « Préface » de Cromwell et de Racine et Shakespeare, ce roman démontre à quel point les œuvres de Shakespeare se sont peu à peu intégrées à la culture littéraire française, avec des références à des pièces comme Othello, Richard III, Hamlet et La Tempête ainsi qu’aux personnages d’Othello, Iago, Richard III, Ariel et Caliban. Même l’idée du « génie » de Shakespeare semble ici aller de soi : dans une réflexion du narrateur de La Cousine Bette sur la grandeur de l’œuvre d’art réussie, le dramaturge élisabéthain est compté parmi « les poètes dans l’humanité » au même titre que Milton, Virgile, Dante et Molière.
C’est encore de « génie » qu’il s’agit pour Florence Krésine, le génie du théâtre de Shakespeare qui hante la fiction, le théâtre et la poésie de Théophile Gautier. En réalité, l’œuvre de Gautier est une œuvre proprement « shakespearienne » en ce qu’elle entretient un dialogue fécond avec le dramaturge élisabéthain. Pour F. Krésine, Gautier se crée une figure hybride d’auteur, qu’elle nomme « Shakespeare-Gautier » et qui témoigne de ses affinités avec un concept pythagoricien de la transmigration des âmes que Shakespeare, pourtant, a raillé – et bien davantage encore Ben Jonson. La transmutation opérée dans le récit fantastique Avatar réunit les âmes et les corps d’Octave-Labinsky et Olaf-de Saville. Dans ce récit, un avatar, qui consiste en la descente d’un dieu sur terre, préside à des métamorphoses quasi ovidiennes, autant dire « shakespeariennes ».
Chacune à leur façon, les études ici réunies témoignent de la présence shakespearienne dans la création littéraire et lyrique au XIXe siècle : discrète ou explicite, niée ou exhibée, la référence à Shakespeare n’est jamais totalement assimilée – elle fait résistance, opposant son noyau d’opacité aux métamorphoses les plus extrêmes qu’on cherche à lui faire subir. C’est peut-être dans ce reste que se niche, justement, ce qui est « shakespearien » : une certaine idée que chaque génération se fait du « génie ».
Table des matières
[1] Victor Hugo, William Shakespeare [1864], in Œuvres complètes : Philosophie, Paris, J. Hetzel & A. Quantin, 1882, p. 14
[2] Voltaire, Lettres philosophiques, « Dix-huitième lettre », « Sur la tragédie », in Mélanges, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1961, p. 81.
[3] [Victor Hugo], Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, 2 t., Paris, Nelson, s.d., t. 2, XLVI, « Cromwell », p. 273.
[4] Stendhal, Racine et Shakespeare, Paris, Le Divan, 1928, p. 50-51.
[5] Balzac, La Peau de chagrin, in La Comédie humaine, éd. Pierre-Georges Castex, Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade », t. x, 1979, p. 111.
[6] George Gordon Byron, Letters and Journals, ed. Leslie Marchand, vol. VI, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1976, p. 129.
[7] Henri Blaze, « Lettre à Rossini à propos d’Othello », Revue des Deux Mondes, t. 8, 1844, p. 167.