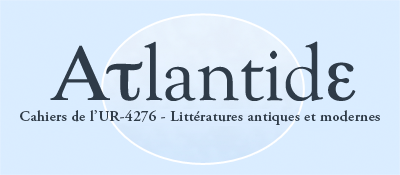6. Violence tragique et guerres antiques au miroir du théâtre et du cinéma (XVIIe-XXIe)
6. Violence tragique et guerres antiques au miroir du théâtre et du cinéma (XVIIe-XXIe)
Sous la direction de Tiphaine Karsenti & Lucie Thévenet
Numéro 6 - Mars 2017
Introduction - Tiphaine Karsenti & Lucie Thévenet.
Que l’on partage ou non les thèses anthropologiques de René Girard sur le lien nécessaire entre mythe, violence, conflit [1], force est de constater la permanence des actes violents dans la mythologie grecque, et ce dès l’origine avec le meurtre primordial d’Ouranos par son fils Cronos. Des dissensions familiales individuelles à l’échelle collective des guerres, les trahisons et les crimes appellent la vengeance et le châtiment, dans un engrenage sans fin de la violence. Depuis le creuset des cycles épiques et de la lyrique chorale, le passage de cette vaste matière à la scène se fait en lien avec l’expérience du régime démocratique dans la cité athénienne et, comme l’ont montré notamment Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, l’idéologie civique et démocratique s’est présentée comme un rempart nécessaire contre cette logique du sang mythique, érigée en contre-modèle. Pour schématiser, au monde de violence et de guerre de l’épopée, dominé par des personnalités d’exception, elles-mêmes guidées par les dieux, la cité et, en son sein, la tragédie opposent un univers dans lequel l’homme possède une part de responsabilité, qui est au cœur du nouveau système juridique et politique.
Pourtant, cette mise en œuvre ne se fait pas sans ambiguïtés, et rien n’est plus équivoque que la tragédie, dont la logique en vient souvent à repousser à l’extrême la violence inhérente au mythe : Euripide innove en faisant de Médée une infanticide ; Sophocle sublime la quête identitaire de son Œdipe en lui faisant se crever les yeux, ce qui n’était pas le cas d’Euripide dans son propre traitement de l’épisode ; et si Oreste vengeait bien son père dans l’épopée, il n’en était pas pour autant matricide à date ancienne. Quant au conflit troyen, l’accent est désormais mis sur la folie d’Ajax, et sur les plaintes d’Hécube, dont le personnage souffrant pourrait incarner le genre lui-même. La société démocratique athénienne trouve ainsi dans le mythe et ses mises en forme un miroir, valorisant ou déformant, qui lui permet de construire son image, pour elle-même ou pour les autres, en jouant sur le double rapport de proximité et d’écart qui la lie à ce fonds commun.
Au fil du temps, l’écart temporel et culturel entre l’univers mythique et le présent historique s’est accru. Mais la sensation d’une intimité imaginaire entre ce patrimoine archaïque et la culture occidentale a perduré, ravivée et attisée par l’humanisme à partir du XVe siècle, puis entretenue par le néo-classicisme, notamment allemand, à l’articulation des XVIIIe et XIXe siècles. Qu’a-t-on fait, dans ce cadre, de la violence omniprésente dans le mythe ? Comment des sociétés chrétiennes et soucieuses de réguler les comportements sociaux ont-elles reçu et transformé cette anthropologie tragique ? Dans quelle mesure les ressources narratives offertes par la mythologie ont-elles pu servir, par ailleurs, à défendre des esthétiques opposées au classicisme ou au néo-classicisme, qui trouvaient précisément dans cet excès leur porte-voix ? Si les valeurs associées à l’antiquité ont pu servir de socle à des normes esthétiques, sociales et politiques, les récits mythiques portent également en germe des ferments de désordre. La légitimité attachée par la culture occidentale aux héritages gréco-romains a alors paradoxalement facilité la légitimation de nouvelles normes esthétiques, éventuellement sociales ou idéologiques.
La violence et la guerre, thèmes retenus pour ce numéro, nous invitent ainsi à réfléchir sur la relation de proximité-éloignement entretenue par la culture occidentale avec le patrimoine mythologique, pris entre les valeurs paradigmatiques associées à l’antiquité en général – sur les plans éthique, politique, esthétique –, et les possibilités transgressives portées par ses schèmes narratifs. Il nous invite aussi à interroger les contextes de création pour décrypter des phénomènes d’appropriation. Le détour par la référence antique, souvent indissociablement mythologique et littéraire, s’inscrit en effet dans une tradition longue de l’intertextualité, et plus largement des pratiques de réception occidentales, mais il procède aussi à chaque fois d’un geste singulier, inscrit dans un contexte historique ou une trajectoire artistique propres. Les guerres et les crises qui jalonnent les XXe et XXIe siècles, notamment, ont suscité de nombreuses analogies théâtrales avec la guerre de Troie, en particulier dans des mises en scène de tragédies grecques qui, explicitement ou non, font signe vers le présent de leur représentation. À travers la violence et la guerre, les contributions de ce numéro appréhendent donc la mythologie dans l’art théâtral ou cinématographique sous deux aspects complémentaires : sa dimension paroxystique dans l’expression et la représentation de la violence ; sa dimension archétypale qui la hisse au rang de paradigme. Ces deux traits, propres aux mythes en général, leur confèrent la capacité de médiatiser, à travers une mise en forme artistique et un détour analogique, les tensions à l’œuvre dans la société ou dans l’histoire. Prises entre universalité et singularité, ces représentations invitent le spectateur, selon l’accent qu’elles choisissent, à mettre à distance le présent pour mieux l’interroger et en saisir la violence, ou, à l’inverse, à gommer ses aspérités pour le hisser à la hauteur du mythe.
Sans chercher l’exhaustivité, ce volume parcourt les siècles, du XVIIe au XXIe, et les pays (France, Grèce, Allemagne, Italie, Portugal, États-Unis), en s’intéressant aux lectures, aux reprises, aux usages de ces motifs grecs antiques dans le théâtre occidental depuis la première modernité. Ce panorama met en évidence le fait que la violence est une construction culturelle, historique et sociale, qui définit des partages à forte implication politique. Les objets d’application de la violence, les seuils de tolérance de la violence, les modes de réaction à la violence ne sont pas les mêmes selon le lieu ou l’époque dans lesquels on se situe, mais ils varient aussi selon les sensibilités artistiques et idéologiques. C’est ce que montrent en particulier trois articles du volume, ceux de Tiphaine Karsenti, Cristina de Simone et Lucie Thévenet. Le premier oppose deux catégories de traducteurs du théâtre grec au XVIIIe siècle autour de la question de savoir si la violence est un obstacle ou un aiguillon pour le plaisir du spectateur de théâtre. Le second rappelle comment dans sa Penthésilée, Heinrich von Kleist prend le contrepied de ses contemporains en faisant de l’irrationalité une valeur, même et surtout si elle s’exprime par la violence. Le troisième montre comment cette violence est poussée à la limite par Kleist, qui combine les sources en les inversant pour construire une Amazone anthropophage, dévorant de la chair crue. Or chez lui comme chez Bene, cette exacerbation transgressive fait signe vers un au-delà de la représentation, dans l’intime du cœur humain (chez Kleist) ou dans le néant métaphysique (chez Bene).
De façon récurrente, dans des périodes de constitution, de consolidation ou de renouvellement de l’identité française, le patrimoine antique a soutenu la construction d’une mythologie nationale : à la Renaissance puis à l’époque dite classique, les modèles grecs et romains ont servi à forger une littérature « noble », destinée à un public d’« honnêtes gens » ; après la guerre de 1870, la référence antique a nourri la représentation d’une France populaire et démocratique (Géraldine Prévot). Les tragédies grecques et romaines, en particulier, ont servi de modèle esthétique, puis de surface de projection des problématiques d’actualité, notamment dans les périodes de guerre, d’abord à travers des réécritures et adaptations, puis, dès la seconde moitié du XIXe siècle, dans les mises en scène des œuvres elles-mêmes. Dans la France des guerres de religion, par exemple, Robert Garnier réécrit Les Troyennes à partir d’Euripide et de Sénèque (1579). Plusieurs articles de ce numéro sont par ailleurs consacrés à l’analyse de mises en scène de L’Orestie (Sofia Frade), des Perses (Haritini Tsikoura, Claire Lechevalier) d’Agamemnon (Estelle Baudou), des Troyennes (Claire Lechevalier) et de Ion (Sofia Frade) aux XXe et XXIe siècles.
Il ne s’agit plus alors de lire la référence antique comme un modèle, mais bien de s’emparer de son pouvoir d’ambivalence intrinsèque, et de notre rapport ambigu à elle, pour interroger le temps présent, à travers des modalités qui vont de l’analogie avec les faits passés jusqu’à leur plus grand éloignement, la marque forte de leur irrémédiable différence (Estelle Baudou). C’est bien la fonction même de la tragédie qui se trouve ici à nouveau questionnée (Claire Lechevalier).
À l’époque contemporaine, une nouvelle ligne de fracture apparaît, que les contributions ici réunies font apparaître : celle qui sépare les pays européens, victimes de la crise économique, du leader du monde capitaliste. La représentation des guerres antiques – la guerre de Troie et les guerres médiques – est en effet mobilisée dans certains pays d’Europe pour interroger, sur un mode analogique, la situation de crise engendrée par l’économie libérale. Au Portugal (Sofia Frade), ou en Grèce (Haritini Tsikoura), des metteurs en scène contemporains se saisissent des tragédies antiques pour faire signe vers la situation présente, dénoncer les souffrances, peut-être suggérer d’autres partages du sensible. Avant eux, Pier Paolo Pasolini utilisait la référence à l’Orestie pour faire ressortir la dimension mythique de la guerre réelle au Biafra, la beauté des humbles, en qui il voyait le seul espoir de résistance contre la violence capitaliste (Anne-Violaine Houcke). À l’inverse, l’industrie hollywoodienne joue avec le motif analogique, en suggérant une référence à la guerre en Irak derrière sa représentation de la guerre de Troie dans Troy. Mais dans ce pays qui ne connaît pas la crise, l’analogie sert surtout à produire des effets de connivence ou de réalisme. Le véritable objet du film, comme le montre Anne-Violaine Houcke, est la glorification du septième art comme nouvelle forme d’épopée, créateur de mythes contemporains. La mythologie et le théâtre grecs sont des références communes aux perdants et aux vainqueurs de la guerre économique contemporaine, mais là où certains inscrivent leur expérience dans le prolongement de la tragédie antique, d’autres s’autorisent à réécrire l’histoire et à rationaliser le mythe, dans un geste démiurgique attirant toute l’attention sur la puissance d’un art audiovisuel à l’ère médiatique, et d’une industrie florissante dans une culture mondialisée.
Si les réécritures, reprises, interprétations et lectures de la tragédie grecque sont constantes et nombreuses en Europe depuis la Renaissance, on observe donc un renouvellement incessant des formes, des usages et des questionnements qu’elle suscite. Dans le monde désenchanté qui est le nôtre, le recours à un espace-temps mythique suppose souvent un retour réflexif sur les formes artistiques elles-mêmes, sur la fonction qu’elles assignent à la fiction et au travail esthétique de la réalité. L’ancrage de ces œuvres dans une civilisation et une culture considérées comme originelles et fondatrices pour l’Europe contemporaine rend en outre ces œuvres signifiantes, au-delà même de leur contenu, dans le cadre d’une crise de la démocratie. Enfin, le lyrisme de la souffrance et les tensions de l’ambiguïté constitutifs des formes tragiques les dotent d’une capacité à exprimer, dans un dispositif indirect, les inquiétudes et les malaises d’une Europe en crise.
Avec nos plus vifs remerciements à Cécile Dudouyt, qui a précieusement contribué à la conception de ce numéro.
Table des matières
[1] Voir La Violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972. « Dans les mythes et les légendes d’où sont tirées la plupart des tragédies, la fraternité est presque toujours associée à la réciprocité de la vengeance. Un examen attentif révèle que le héros tragique par excellence n’est pas l’individu solitaire, l’Œdipe de Freud et de la Poétique d’Aristote, mais le couple des frères ennemis, Étéocle et Polynice, Hamlet et Claudius. » (René Girard, Shakespeare. Les feux de l’envie, Paris, Grasset, 1990, p. 334).