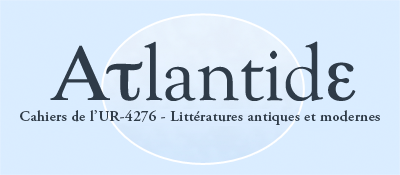3. Fiction et histoire. France-Italie
3. Fiction et histoire. France-Italie
Sous la direction d’André Peyronie
Numéro 3 - Juillet 2015
Les essais qui suivent, présentés à Nantes lors d’une journée d’études franco-italienne, le 17 avril 2014, ont eu pour projet commun de poser la question de la prise en charge de l’Histoire par des textes mêlant fiction et historiographie, ou par des supports entretenant un rapport d’intertextualité ou d’intermédialité à la fois avec la littérature et l’Histoire. Elles ne concernent pas – sauf l’avant-dernière – le roman historique en tant que tel, c’est-à-dire en tant que genre. Même si cette question classique garde toute son actualité, il nous a semblé utile d’ouvrir la réflexion à une problématique plus transversale, celle de l’impact de la fiction (quel que soit le type de fiction choisi) sur le pacte de vérité auquel s’engage l’historiographie, ainsi que sur le pouvoir que peut avoir la fiction pour penser l’Histoire de manière critique, et pour agir sur elle. Le champ d’investigation a été limité à la France et à l’Italie, mais sans exclusion chronologique, de façon à faciliter, par la mise en perspective temporelle, la problématisation et la réflexion critique.
Les trois premières études des « Actes » ici proposés concernent toutes un ou plusieurs personnages historiques, et elles ont à voir avec le genre de la biographie. Mais nous sommes évidemment bien loin des exigences de la biographie moderne, de celle des historiens du moins. La contribution d’Elisabeth Gaucher-Rémond aborde le Livre des faits de Boucicaut (1409), récit de vie à tendance hagiographique visant à réhabiliter le Maréchal de Boucicaut, et, au-delà du personnage historique, la chevalerie en général. L’auteur anonyme se porte ouvertement garant de l’authenticité de son récit, mais emprunte d’autant plus librement à la tradition littéraire, en particulier romanesque, que la frontière entre fiction et histoire n’est pas à l’époque vraiment fixée. Cet emprunt permet à la fois la construction d’un portrait où la noblesse de Charles VI pouvait reconnaître plusieurs de ses idéaux, et la production d’un plaidoyer dont les lignes de force relèvent de la propagande et du contrôle de l’opinion publique. Les Amours des grands hommes (1671) de Madame de Villedieu, étudiés par Nathalie Grande, se présentent comme un recueil de biographies tendant à rendre compte de la carrière des grands hommes par leur vie amoureuse. Ramenés de ce point de vue à une commune mesure, Solon, Socrate, César ou Pompée se trouvent désacralisés, humanisés, et quelquefois même clairement ridiculisés. Mais au-delà du renversement de la traditionnelle « vie des hommes illustres », par le biais amoureux, des figures féminines entrent ainsi dans la sphère politique. Et la nouvelle historique, dans la version galante de Madame de Villedieu, peut alors jouer son rôle dans l’évolution des mœurs de l’époque. Enfin, L’Histoire de la peinture en Italie (1817), objet de l’article de Marie-Pierre Chabanne, rassemble des textes sur la peinture italienne qui se focalisent sur tel ou tel peintre comme, au livre sept, sur Michel-Ange. Pensant que la vie de l’homme doit être en syntonie avec la beauté de l’œuvre, Stendhal procède à un travail d’épuration et d’ennoblissement des faits historiques, et dresse, à en juger par les témoignages des contemporains, un portrait idéalisé et fort hypothétique du grand artiste. C’est que le but n’est pas tant d’établir la vérité que de donner une leçon de vertu civique et d’exhorter les lecteurs au sublime. Ainsi naît le mythe héroïque et romantique de l’artiste sur le champ de bataille.
Chacun des deux articles qui suivent s’intéresse à un roman qui peut être considéré comme un hybride générique rencontrant la forme du roman historique, mais aucun des deux ne se soucie de le réinscrire dans la problématique du genre. Leur intention est avant tout de montrer que la prise en charge du moment historique choisi par les deux récits débouche in fine sur la question de l’influence que le roman pourrait éventuellement exercer sur l’Histoire. Il porto di Toledo d’Anna Maria Ortese (1975), étudié par Siriana Sgavicchia, est ainsi le récit de la vocation d’écrivain d’une petite fille, à Naples, dans les années 30. L’article montre comment, dans les événements de l’époque, on peut percevoir, comme en superposition, ceux de 1968. Dans Naples réinventée, s’affirment en effet des idéaux de liberté, de justice sociale et d’égalité des sexes. Ainsi la dimension de la mémoire et la surimpression du futur contribuent-elles à faire du roman une réflexion sur le devenir historique, et à le colorer en utopie politique. Le travail pourtant remarquable des historiens ne suffisant apparemment pas à arrêter la diffusion de cette immonde forgerie que constituent les Protocoles des sages de Sion, Umberto Eco entreprend quant à lui, dans Le Cimetière de Prague (2010), de traiter le mal par le mal, c’est-à-dire de combattre le délire antisémite par un délire romanesque, comme le montre l’analyse d’André Peyronie. Un anti-héros faussaire et assassin dont la haine des juifs s’est alimentée aux pamphlets de l’époque et s’est combinée à l’idée de complot typique des romans populaires de Sue ou Dumas devient ainsi, à la fin du XIXe siècle, l’auteur – fictif évidemment – des Protocoles. Dans le même mouvement, le roman tend à se faire lui-même roman populaire en espérant pouvoir agir, positivement cette fois, sur l’Histoire.
Les deux derniers articles embrassent plus largement les champs italiens du roman et du cinéma contemporains dans leur rapport à l’Histoire. Celui de Catherine de Wrangel montre d’abord comment le rapport postmoderne au temps se traduit, sur le plan romanesque, par un certain nombre de traits récurrents : refus des grandes utopies émancipatrices, ironie, parodie, hybridation de la culture savante et de la culture de masse, métissage des codes et des genres, hétérogénéité… Complémentairement, littérature et historiographie tendent à se rapprocher, la première s’appropriant des notions ou des outils comme ceux de documents, d’archives, de témoignages, la seconde s’emparant de plus en plus de modes d’écriture et de pratiques littéraires. Cependant, dans la production du collectif d’écriture Wu Ming représentative des expérimentations en cours et où un roman sur cinq est un roman historique, la fiction tend à mettre la puissance nouvelle qu’elle acquiert au service d’une volonté de transformation sociale. L’étude de Salvatore Cingari s’intéresse d’abord au film historique « en costume », mais élargit bientôt son enquête à la vision de l’Histoire et de la société italiennes que présente, à travers quelques-uns de ses productions les plus caractéristiques, la cinématographie contemporaine (2001-2013). L’analyse qui s’appuie sur la catégorie gramscienne de révolution passive, sur l’intuition foucaldienne d’une fragmentation oligarchique endémique dans la péninsule, et sur la vision du pouvoir proposée par Guy Debord, fait apparaître comme dernier aboutissement un grand vide auquel font écho les processus de marchandisation en cours sur le plan mondial.
Ainsi, dans toutes les œuvres prises ici en compte, la matière est historique, et la forme générale d’appréhension de cet historique est le récit. La première question que posent les contributeurs, est, inévitablement, celle des moyens mis en œuvre par ce récit. La seconde est, à partir de la première, celle de son idéologie. Tant il est encore nécessaire de comprendre comment, délibérément ou non, consciemment ou non, une forme porte en elle une dimension idéologique.
Dans les trois premiers exemples (l’historiographe du maréchal de Boucicaut, Madame de Villedieu, Stendhal), la mise en récit des « faits historiques » s’effectue sur le modèle et à la lumière, successivement du roman courtois, de la nouvelle galante, et du mythe héroïque. Les outils littéraires permettent de s’emparer d’un réel historique et surtout de le configurer de manière très orientée. Nous sommes ainsi confrontés à l’utilisation spontanéee ressorts littéraires à des fins engagées. La littérature n’y est pas tant au service de l’Histoire que de cet engagement.
Dans le cas des deux romans singuliers, nous sommes d’emblée dans une sorte de roman historique doublé d’une pseudo-confession (Anna-Maria Ortese), ou d’un pseudo-roman populaire (Umberto Eco). On ne peut pas être plus clairement dans la littérature. Mais l’objet du roman est un moment de l’Histoire (l’Italie des années trente, l’Italie et la France du XXe siècle), et sa restitution sous telle forme précise vise à permettre, par la mémoire utopique ou le romanesque débridé, un progrès des consciences. La littérature ici ne désespère pas d’agir directement sur l’Histoire.
En cernant l’écho de ces toutes dernières années de l’Histoire italienne dans le roman historique et dans le cinéma contemporains, les deux dernières communications rejoignent une problématique de sociologie de l’art. L’écriture romanesque ou cinématographique apparaît d’abord comme une sorte de tensiomètre enregistrant les évolutions de l’Histoire. Mais en donnant forme, les romans et les films transforment et transcendent, et donnent alors à voir, dans leur grammaire nouvelle, le plus-que-présent.
Au total, on le constate, les sept coups de sonde ici proposés dans des œuvres de natures et d’époques diverses nous placent à chaque fois dans la question centrale de l’élaboration littéraire et dans celle, complémentaire et capitale, de sa responsabilité morale et politique.
Catherine de Wrangel, Dominique Peyrache-Leborgne, André Peyronie, co-organisateurs de la journée d’études « Texte/histoire : France-Italie » tenue à l’Université de Nantes, le 17 avril 2014.