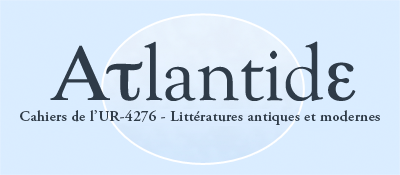5. Traducteurs dans l’histoire, traducteurs en guerre
5. Traducteurs dans l’histoire, traducteurs en guerre
Sous la direction de Christine Lombez
Numéro 5 - Juillet 2016
Va par mille beaux faits mériter son estime ;
Sers un si noble maître ; et fais voir qu’aujourd’hui,
Ton Prince a des sujets qui sont dignes de lui. »
Avant-propos - Christine Lombez.
Tel est le conseil que Nicolas Boileau donnait à un futur écrivain dans sa Ve Satire dédiée au Marquis de Dangeau (1664), laissant clairement apparaître qu’à ses yeux, les rapports du prince et de l’écrivain sont subtilement régis par la loi d’un intérêt réciproque bien compris. Presque trois siècles plus tard, Valery Larbaud voit également dans le traducteur un serviteur : « “servir” est sa devise, et il ne demande rien pour lui-même, mettant toute sa gloire à être fidèle aux maîtres qu’il s’est choisis, fidèle jusqu’à l’anéantissement de sa propre personnalité intellectuelle. » [1] De fait, le traducteur, écrivain sui generis, n’échappe pas à des relations avec le pouvoir (temporel ou spirituel), qui peuvent se révéler des plus périlleuses. L’histoire de la traduction est remplie d’exemples révélant les risques du métier de traducteur, tel Étienne Dolet brûlé sur le bûcher place Maubert à Paris en 1546 pour avoir, dit-on, mal interprété un passage d’un des Dialogues de Platon, ou encore William Tyndale (premier traducteur de la Bible en langue anglaise) qui connut quelques années auparavant un sort analogue à celui de son collègue français. Si aujourd’hui on ne brûle plus les traducteurs en place publique pour les châtier de leurs (soi-disant) mauvaises traductions, pour autant, dans certaines régions du monde exposées à des actions militaires, les traducteurs voient toujours régulièrement leur vie menacée. Ainsi, de nos jours, en zone de conflits (Irak, Afghanistan), les interprètes locaux de l’OTAN ou d’autres coalitions internationales ont-ils dû souvent cacher leur visage pour ne pas être identifiés par leurs compatriotes. Cela ne suffit toutefois pas pour leur éviter de se faire abattre – le traducteur étant alors considéré comme un traître, version moderne et tragique du célèbre traduttore, traditore.
Pour qui pense aux liens unissant, dans l’Histoire, le pouvoir politique et la traduction, un personnage vient fréquemment à l’esprit : celui du « truchement ». Si l’étymologie du mot, « drogman » (désignant les traducteurs-interprètes qui travaillaient pour la Sublime Porte à Constantinople), atteste bien son origine levantine, l’image de mauvais traducteur, tant raillée par Molière dans ses pièces, est pourtant loin d’être une fable. En effet, les truchements falsifiaient souvent les contenus qu’ils avaient à traduire afin de ne pas déplaire au Sultan (ils pouvaient le payer de leur vie) [2]. En conséquence, les ambassades étrangères auprès de la Porte n’employaient pas des traducteurs officiels mais avaient recours à du personnel bilingue non musulman (par exemple les Phanariotes, des Grecs polyglottes vivant à Constantinople). La méfiance à l’égard des drogmans originaires d’Orient, jugés insuffisamment fiables pour défendre avec sincérité les intérêts des pouvoirs concernés eut quelques répercussions. En France, une ordonnance de 1721 modifia le statut des futurs « drogmans », afin qu’à l’avenir on pût être assuré de leur fidélité et de leur bonne conduite : désormais ces jeunes gens, fils de parents français, seraient tenus de prêter serment. Ainsi le drogman devint-il un personnage officiel assermenté, relevant de la juridiction royale. Le lien avec le pouvoir s’en trouva d’autant plus renforcé – une constante à travers les siècles, même si la pratique des traducteurs (ou des interprètes) alla en s’autonomisant au fil du temps et de la création d’un cadre légal encadrant de plus en plus étroitement leur activité (naissance d’un droit du traducteur au cours du XIXe siècle consacré par la Convention de Berne en 1886 ; existence de codes de déontologie des traducteurs et des interprètes).
Cependant, les rapports entre la politique et la traduction ont de multiples facettes et remontent à plus loin encore. Ainsi, durant le Moyen-Âge en France, marchant sur les traces du roi d’Angleterre Alfred le Grand au IXe siècle, le roi Charles V, dit « le Sage » (1338-1380) est réputé avoir accordé une grande importance à la traduction. Il en commissionna de nombreuses (Saint Augustin, Tite-Live, Aristote, ou la Bible), dynamisant ainsi l’activité de traducteurs dont les noms (Nicolas Oresme et Raoul de Presle qui faisaient partie de son proche entourage) nous sont encore connus. La Cour de France y acquit un certain lustre intellectuel. Un siècle et demi plus tard, ce fut Jacques Amyot (1513-1593) qui, appelé « le Prince des traducteurs » pour sa traduction des Vies parallèles des hommes illustres de Plutarque, lue jusqu’au XVIIIe siècle au moins (cette traduction – en version anglaise – a également inspiré Shakespeare), a aussi contribué, selon les mots de Montaigne, à sortir le français de son « bourbier ». Or en un XVIe siècle plus troublé que jamais du point de vue politique et religieux, les liens de Jacques Amyot avec le pouvoir étaient alors très étroits : dans le contexte de la Renaissance où les Humanités faisaient l’objet de toutes les attentions royales (sous le règne de François 1er puis d’Henri II), Amyot officiait aussi comme précepteur des fils d’Henri II (Charles IX, Henri III, deux futurs rois de France). Il utilisera d’ailleurs son Plutarque comme manuel pédagogique (l’œuvre avait été traduite à la demande de François 1er).
À la même époque en France et en Europe, c’est une autre traduction, celle de la Bible, qui exacerbait les tensions avec le pouvoir, qu’il s’agisse de l’autorité royale ou de l’Église. En Angleterre, en 1536, le traducteur William Tyndale, jugé coupable d’hérésie et de trahison, fut condamné au bûcher (ses derniers mots auraient été : « Seigneur, ouvre les yeux du roi d’Angleterre ! »). La Réforme avait en effet entraîné la nécessité de produire de nouvelles Bibles protestantes, une entreprise dont le risque n’était pas à sous-estimer, comme en témoigne un autre destin, celui de Pierre-Robert Olivétan, cousin de Calvin et auteur d’une traduction de la Bible en 1535 qui lui coûta sans doute la vie (Olivétan fut empoisonné et mourra à l’âge de 40 ans). Au siècle suivant, un célèbre traducteur, Isaac Lemaître de Sacy, dut à sa proximité avec le milieu janséniste de Port-Royal, alors en disgrâce auprès du Roi-Soleil, un long séjour à la Bastille. Sa traduction du Nouveau Testament, sauvée in extremis par ses amis, sera exfiltrée de France et publiée à Amsterdam sans nom d’auteur en 1667 (la « Bible de Mons »).
Les enjeux de la traduction s’amplifièrent à l’ère moderne avec des moyens de communication accrus, et ses liens avec le pouvoir et l’Histoire s’en trouvèrent renforcés : le cas célèbre de la Dépêche d’Ems (1870) [3] est là pour révéler qu’un problème mineur de traduction peut parfois déboucher sur une guerre. On sait que le traducteur français de la dépêche avait employé le terme « adjudant » afin de traduire le mot allemand Adjudanten [4] qui signifie en allemand « aide de camp ». Le faux-ami « adjudant », grade de l’armée considéré comme très subalterne en France par rapport à l’Adjudant prussien, et donc insultant, contribua à mettre davantage le feu aux poudres entre les deux pays, ce qui était, semble-t-il, l’intention de Bismarck (« il produira là-bas, sur le taureau gaulois, l’effet du chiffon rouge », aurait-il déclaré). Plus récemment et plus tragiquement encore, la catastrophe d’Hiroshima (1945) pourrait avoir eu une origine liée à une question de traduction. Pour exprimer sa réaction face à l’ultimatum américain, le gouvernement japonais avait employé le verbe mokusatsu, un mot pouvant à la fois signifier « ignorer » et « s’abstenir de tout commentaire » [5] ; le traducteur ayant interprété cette réponse comme un silence méprisant, la première bombe atomique de l’Histoire fut larguée. « War is what happens when language fails » : cette phrase emblématique de la Canadienne Margaret Atwood résume de manière saisissante les enjeux inhérents à l’acte de communication qu’est, fondamentalement, toute traduction.
Il n’est pas rare d’ailleurs que dans un XXe siècle riche en guerres et en régimes totalitaires, la traduction ait souvent été l’otage de pouvoirs coercitifs exercés à la faveur d’un conflit armé. On en trouve l’exemple en France sous domination allemande pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-44). L’Occupant marqua très vite, par des signes qui ne trompaient pas, sa volonté de mettre au pas les milieux intellectuels et artistiques : aryanisation des maisons d’éditions ainsi que de la presse et, plus largement, des moyens d’information, écrémage des bibliothèques et des librairies suivant la ligne directrice de différentes listes de censure issues des services de la propagande. La liste Bernhard (excluant les ouvrages véhiculant des points de vue antinazis ou plus généralement antiallemands) puis les versions successives (1940, 1942, 1943) de la liste Otto (répertoriant les ouvrages indésirables d’auteurs allemands, français, anglais, polonais, notamment juifs ou communistes) servirent de tels desseins. La traduction de la littérature étrangère fut également au centre des mesures édictées par les autorités d’Occupation. Ce fut l’Aktion Übersetzung (ou programme de traductions prioritaires) pilotée par l’Institut Allemand de Paris alors dirigé par Karl Epting, un ami de Céline. L’enjeu, de taille, ne visait pas moins qu’à rééduquer le lectorat français et à contrôler le processus de germanisation culturelle de la société, même si tout fut mis en œuvre pour donner l’impression que l’initiative de ces publications provenait des éditeurs français. Et face à des traductions trop visiblement récupérées par l’idéologie dominante, la réponse venait parfois elle aussi sous forme de traductions. C’est ainsi que le 14 juillet 1944 parut aux Éditions de Minuit, pour le Comité National des Écrivains (organe de la Résistance littéraire), un petit livre d’une cinquantaine de pages dont le titre, Les Bannis – Poèmes traduits de l’allemand, était à lui seul tout un programme. Dans cet exemple de « contre-anthologie », il s’agissait de rétablir une vérité et de laver l’honneur de la poésie allemande, abusivement compromise à des fins de propagande dans les deux volumes de l’Anthologie bilingue de la poésie allemande des origines à nos jours parue chez Stock en 1943 [6]. Contre le « mensonge », et au nom de la « vérité bafouée », pour défendre tout un patrimoine poétique (Schiller, Goethe, Hölderlin) indûment annexé par l’Allemagne nazie, le geste anthologique devenait essentiellement politique – la traduction de la poésie allemande servant de prétexte à une confrontation qui excédait, de loin, la volonté affichée de rendre aux poètes d’outre-Rhin leur honneur perdu.
Dans une perspective différente mais restant assez proche sous certains aspects, le cas de l’écrivain et traducteur russe Boris Pasternak, Prix Nobel de Littérature en 1958, dont la vie fut tout entière marquée par un conflit profond avec le pouvoir soviétique suite à son refus de se laisser récupérer (avec pour conséquences ostracisation et exil intérieur), est une illustration parfaite de ce que permet la traduction dans un contexte politique totalitaire. À la fois échappatoire (traduire devenant un moyen détourné pour s’exprimer et faire passer des messages subversifs, comme le révèlent ses traductions en russe de Shakespeare, notamment Hamlet [7]), la traduction se révéla aussi la « planche de vivre » (René Char) de nombreux écrivains et poètes réduits au silence. Boris Pasternak fut même, malgré lui, un cas d’école avec son Docteur Jivago, alors impubliable en URSS. Parue pour la première fois en italien, puis en français et en anglais, la traduction de son roman en Occident, si elle lui donna le Prix Nobel, valut également à son auteur le déclenchement par Moscou d’une cabale d’une violence inouïe pour trahison, qu’il paya finalement de sa vie.
Les exemples qui viennent d’être évoqués montrent, à des degrés multiples, la diversité des rapports ayant existé à travers les siècles entre certaines idéologies dominantes, les traducteurs, ainsi que leurs possibles – et très concrètes – répercussions historiques. L’ambition du présent numéro d’Atlantide est d’évoquer, grâce à une série d’études de cas [8], le destin souvent tumultueux de ces passeurs, de faire apparaître quelques traits précis de leurs liaisons parfois dangereuses avec la politique, et de souligner de facto l’importance du rôle historique (voire même idéologique) joué par les traducteurs dans un passé récent ou plus ancien.
Ainsi dans « Le génie des langues, notion poétique ou politique ? », Claire Placial pose-t-elle, à l’aide de l’exemple de la traduction de textes bibliques d’hébreu en français, une question des plus épineuses. Non dénuée d’impensés idéologiques, politiques et même racistes, cette notion de « génie des langues » sous-tendant parfois certains gestes traductifs fut véhiculée par les traducteurs des Écritures depuis la Réforme jusqu’au XIXe siècle.
Avec « Clément Pansaers et la traduction de la littérature expressionniste dans la revue Résurrection (1917-1918). Un transfert culturel franco-allemand en Belgique occupée », Hubert Roland s’intéresse au cas atypique du dadaïste belge Clément Pansaers qui traduisit des auteurs expressionnistes allemands en français en Belgique occupée durant la Première Guerre mondiale. Il questionne également l’étonnante tolérance dont ces traductions firent l’objet de la part de l’Occupant allemand en dépit de la ligne clairement pacifiste et internationaliste de la revue Résurrection dans laquelle elles parurent.
Toujours durant la Grande Guerre, l’étude d’Amélie Auzoux sur « André Gide et Valery Larbaud, deux traducteurs en guerre (1914-18) » permet d’apprécier à quel point la traduction put se révéler une arme redoutablement efficace pour Larbaud et Gide afin de promouvoir, en temps de conflit, une passionnée « défense et illustration de la langue française ».
D’une guerre à l’autre, les traductions du XXe siècle demeurèrent au centre de l’intérêt des vainqueurs qui y voyaient un moyen subtil de rééducation des territoires conquis. La nature et l’ampleur de cette emprise idéologique sont discutées par Alexis Tautou à travers l’exemple du poète germanophone R. M. Rilke (« Traduire et éditer Rainer Maria Rilke sous l’Occupation ») dont on découvre qu’il fut un auteur emblématique tenu pourtant en suspicion par l’Occupant allemand en raison de ses positions trop cosmopolites, de sa francophilie, et surtout de ses origines tchèques.
Que la traduction puisse être récupérée et orientée à des fins politiques ou idéologiques ressort on ne peut plus clairement des travaux présentés par Yanna Guo (« Michelle Loi, une combattante comme ça. Portrait d’une traductrice engagée de Lu Xun en France ») et Ioana Popa (« Traduction et sédition. Circulations clandestines transnationales des œuvres en contexte non démocratique »). Le destin de l’écrivain Lu Xun, érigé bien malgré lui en icône de la Chine communiste, dont l’œuvre en traduction française fut ensuite orientée dans un sens maoïste par Michelle Loi (elle-même très marquée politiquement), permet de se faire une idée de la responsabilité des traducteurs dans un contexte idéologiquement surdéterminé. À rebours, à l’époque de la Guerre froide et jusqu’à la chute du mur de Berlin, la traduction put se révéler un moyen efficace pour miner des idéologies dominantes comme le démontre Ioana Popa. C’est en effet par la circulation souvent illicite de textes traduits à l’aide de circuits de diffusion clandestins et/ou périphériques, que certains auteurs du bloc socialiste (Boris Pasternak, Bohumil Hrabal), réduits au silence dans leurs pays respectifs, purent faire connaître leur œuvre en Occident et y trouvèrent, au moyen de la traduction, une légitimation symbolique valant claire dénonciation des régimes totalitaires en place.
Même si elle a été souvent considérée comme une activité marginale, à la visibilité réduite, ou peut-être justement grâce à ce fait même, la traduction – et ses acteurs – s’est bel et bien révélée au fil des siècles un instrument de transmission redoutable car potentiellement manipulable, une « 4e arme » de plein droit (Eva Gravensten), dont l’impact historique et idéologique n’est plus à sous-estimer.
Table des matières
[1] Valery Larbaud, Sous l’invocation de Saint Jérôme, Paris, Gallimard, 1946, p. 9.
[2] Voir David Bellos, Le Poisson et le Bananier. Une histoire fabuleuse de la traduction, Paris, Flammarion, 2011, p. 138.
[3] Le 21 juin 1870, la candidature du prince Léopold de Hohenzollern au trône d’Espagne suscite l’opposition de la France, craignant d’être encerclée entre les États de la Prusse et l’Espagne. Le 12 juillet, sous la pression française, le prince se retire, le but est en apparence atteint. Le ministre des Affaires étrangères mandate alors l’ambassadeur de France auprès du roi de Prusse pour qu’il confirme ce renoncement. Agacé, le roi, qui séjourne dans la ville thermale d’Ems, fait savoir à l’ambassadeur qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce qui vient d’être décidé. Il informe son chancelier Bismarck, dans la « dépêche d’Ems », de la conversation avec le ministre français. Comprenant le parti qu’il peut en tirer, le chancelier allemand modifie le texte, le fait traduire à Berlin, puis prend l’initiative d’une provocation en l’adressant aux journaux français. Piquée au vif, la presse parisienne dénonça l’affront et le piège se referma, entraînant le début de la guerre franco-prussienne de 1870.
[4] Voici le texte exact de la dépêche (tel que restitué dans les Souvenirs d’O. von Bismarck) : « Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, daß Seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzutheilen habe. » (Sur ce, Sa Majesté le Roi a refusé de recevoir encore une fois l’ambassadeur de France et lui a fait dire par l’aide de camp de service que Sa Majesté n’avait plus rien à communiquer à l’ambassadeur).
[6] Voir Christine Lombez, « Pour l’honneur des poètes allemands : la traduction comme acte politique et critique (le cas des Bannis, 1944), dans Isabelle Poulin (dir.), Critique et Plurilinguisme, Paris, Société Française de Littérature Générale et Comparée ; Nîmes, Lucie Éditions, coll. « Poétiques Comparatistes », 2013.
[7] Voir Christine Lombez, La Seconde Profondeur. La traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XXe siècle, Paris, Les Belles-Lettres, coll. « Traductologiques », 2016.
[8] Les contributions ici réunies ont été pour partie présentées lors du séminaire « Politique et traduction » tenu au sein du laboratoire L’AMo entre 2012-2014, ainsi qu’à l’occasion de la rencontre « La traduction littéraire en temps de guerre. 1914-18/1939-45 » organisée dans le cadre du programme de recherches IUF « Les Traductions sous l’Occupation – France, Belgique 1940-44 » (www.tsocc.univ-nantes.fr) en juin 2015 à l’Université de Nantes.